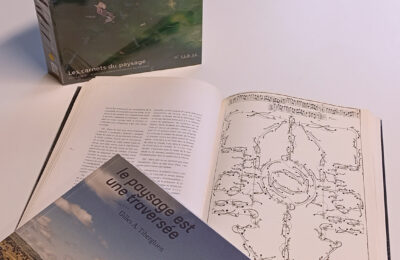NDD # 77 – Explorer les traces

Par Marina Nordera
Peut-on considérer les traces laissées par les pratiques dansées et l’art chorégraphique du passé comme des ressources performatives pour l’historien/danseur et le danseur/historien qui les actualisent dans le présent ?
Écrire/danser l’histoire de corps dansants qui ont disparu depuis longtemps est possible parce que, bien que phénoménologiquement1 perdus, ils ont laissé des traces. Entité matérielle, la trace est une marque ou une empreinte générée par le passage d’un être vivant, par une action ou un événement qui a eu lieu dans le passé. Figure de l’insaisissabilité et de la métamorphose, aucune trace n’existe sans qu’une activité, un mouvement, un geste, un fragment de vécu l’ait produite. L’historien, tout comme le danseur, ne trouve pas ces traces sur son chemin par hasard, mais il doit faire quelque chose pour les voir affleurer à sa conscience, les saisir, les accueillir, les partager et les constituer en savoir. Il se tient à l’affût, dispose des filets, il accomplit (performe) des actions, il mène une enquête. Il se met en recherche. Il trace des liens entre les traces qu’il trouve, ainsi qu’entre lui et les traces qu’il actualise. Entre-temps, il en produit d’autres. Par ces opérations il explore la performativité de la trace. Ses gestes et ses actions résultent de la mise en œuvre de critères sélectifs teintés de son appréhension sensible du monde, de sa posture corporelle, intellectuelle et idéologique, tout comme de la mémoire culturelle2 qu’il partage avec d’autres individus. Pendant qu’il retrace ces réseaux de traces, seule une partie de celles-ci s’inscrit dans son corps. Il en choisit certaines, il en transmet d’autres, il en oublie ou refoule la plupart. Il est le sujet actif d’une opération de filtrage, analogue à celle que le philosophe Jacques Derrida a mis en lumière au sujet des archives3. Toutefois, toutes les traces mnésiques, même celles enfouies en deçà de sa conscience, agissent dans son corps. Restes persistants d’une absence, elles sont insaisissables autant que productives.
La trace s’inscrit dans l’histoire
Les disciplines impliquées dans la recherche du passé – l’archéologie, l’histoire, la philosophie –, mais aussi la psychologie et la psychanalyse commencent à s’intéresser à la trace vers la fin du XXe siècle dans le cadre d’une mise en discussion théorique et méthodologique des paradigmes de l’historiographie4. Elles ouvrent ainsi la voie à une critique du statut des documents et des témoignages dans la construction du récit historique et dans le rapport de ce celui-ci à la vérité5. L’historien et philosophe Michel Foucault a montré que dans le monde naturel apparaissent des signatures qui en indiquent l’ordonnancement pour qui sait les lire6. De plus, comme le suggère le philosophe Paul Ricœur, n’importe quelle trace laissée par le passé, surtout si elle n’est pas destinée, comme l’archive, à une permanence future, devient un document dès lors que l’historien sait l’interroger et la mettre au service de la construction du récit historique7. C’est ainsi qu’a pris corps et racines l’hypothèse que l’étude du passé puisse se fonder sur des traces capables de révéler les qualités invisibles ou invisibilisées (impensables et impensées) des faits, des évènements et des objets. Cet intérêt a conduit à l’élaboration de nouveaux modèles épistémologiques8 pour l’étude des indices, détails généralement négligeables qui échappent à la plupart des gens, et que l’historien Carlo Ginzburg propose d’utiliser dans l’écriture de l’histoire pour sortir de l’impasse entre rationalisme et irrationalisme9. Plus récemment, Laurent Olivier affirme que sa discipline, l’archéologie, n’étudie pas le passé en tant que tel, comme le ferait l’histoire, mais ce qui subsiste matériellement du passé dans le présent, grâce aux vestiges qui transmettent la mémoire des lieux et des objets10. En arrière-plan de ces réflexions, comme des résonances, s’esquissent : l’hypothèse du fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud, d’une acquisition phylogénétique des traces mnésiques laissées en nous par les expériences des générations antérieures11; l’étude des survivances des images à travers le temps inaugurée par le théoricien de l’art Aby Warburg et développée par Georges Didi-Huberman12; l’invitation du philosophe Walter Benjamin à diriger notre regard sur cet amoncellement de ruines qu’est le passé13.
La trace s’inscrit dans le corps
Si l’historien ou l’archéologue s’attache à l’étude des traces dans les écritures, les images et les objets, l’historien/danseur et le danseur/historien focalisent leur attention sur les rémanences et les marques que l’expérience du geste et du mouvement a laissées dans les corps. L’inscription corporelle de la trace en tant qu’outil de mémoire fonde traditionnellement la transmission des pratiques dansées. En remontant les strates du temps, quand il s’agit d’étudier les pratiques dansées et les savoirs du corps d’un passé révolu, la chaîne de la transmission vivante s’interrompt irrémédiablement : aucune trace ne survit qu’on pourrait apprendre par corps de quelqu’un qui à son tour l’aurait apprise par corps. La trace s’émancipe ainsi de la transmission traditionnelle de la mémoire culturelle incorporée (le passé dont on se souvient) et rentre dans l’histoire sous forme d’objet ou de document (le passé en tant que tel)14.
La productivité de la trace, entre perte et saturation
Selon le philosophe Giorgio Agamben, une société qui a perdu ses gestes, tout en cherchant à se les réapproprier, en enregistre la perte15. La conscience de cette double dynamique – entre perte et appropriation – invite à interroger le travail que l’historien/danseur applique aux traces pour restituer une forme chorégraphique ou un geste dansé du passé. Si pour une première génération de chercheurs la restitution des pièces chorégraphiques du passé avait pour but principal la représentation scénique de type historiciste des œuvres canoniques, visant à faire revivre le passé dans le présent comme une réminiscence, plus récemment l’actualisation de ce qui a été est conceptualisée par l’historien/danseur Mark Franko comme un moyen d’interroger la relation entre présent et passé dans sa radicalité matérielle16.
Les technologies numériques permettent une multiplication pléthorique et un dépôt immédiat des traces audiovisuelles des activités humaines que chacun peut facilement produire, reproduire et partager. Une multitude de supports médiatise l’expérience de la danse dans toutes ses formes et à toutes les latitudes. Le danseur/historien peut disposer d’une quantité exponentielle de traces du corps dansant. D’une part, ces matériaux lui donnent l’illusion de pouvoir défier l’impermanence et accéder à la réalité du vécu. D’autre part, submergé et hyper stimulé par la reproduction du réel, il cherche des stratégies pour déjouer la saturation à travers la création de dispositifs fictionnels, parce que, selon l’intuition heureuse du philosophe de l’histoire Michel de Certeau, « l’homme n’a ni goût, ni inclinaison à recevoir la vérité »17.
L’exploration de la trace du passé, en vue de sa restitution dans le présent, n’est pas le signe d’un repli nostalgique ni d’une célébration visant à la canonisation des œuvres, mais un outil critique forgé dans le présent. En effet, le danseur expérimente au quotidien son aptitude à se réapproprier les gestes : saisir, intérioriser, remémorer et restituer les traces du mouvement d’autres corps, dansant ou simplement vivant autour de lui. En tant que danseur/historien, par cette capacité d’incorporation, il sait activer les traces des corps dansants dont, en dansant, il enregistre la perte. De cette manière il expérimente la manière qu’ont les traces de façonner son corps aujourd’hui et de stimuler une circulation active entre le présent, le passé et le futur. L’anachronisme est assumé comme méthode et le présent, comme lieu privilégié de l’articulation entre la prise de conscience de l’historicité de la trace et sa capacité à révéler l’inconscient de l’histoire. Par la mise à l’épreuve du corps que le travail de la danse implique, la trace, grâce à sa nature résiduelle et incomplète, se révèle dans toute sa productivité, comme une source vivante toujours active dans la double dynamique qui s’inscrit entre perte et appropriation.
1 La phénoménologie étudie l’expérience vécue, la perception et la conscience du sujet.
2 Cette notion est employée dans l’acception élaborée par les égyptologues Aleida et Jan Assmann (La mémoire culturelle. Écriture, souvenir et imaginaire politique dans les civilisations antiques, Aubier, Paris, 2010).
3 Jacques Derrida, Mal d’archive. Une impression freudienne, Paris, Galilée, 1995.
4 L’ensemble des méthodes et des postulats théoriques permettant l’écriture de l’histoire. Inscrits dans le flux de l’histoire, ils sont eux-mêmes sujets à modification.
5 Paul Ricœur, Histoire et vérité, Seuil, Paris, 1955.
6 Michel Foucault, Les mots et les choses, Gallimard, Paris, 1966.
7 Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000.
8 Qui se réfère à la théorie de la connaissance.
9 Carlo Ginzburg, « Signes, traces, pistes. Racines d’un paradigme de l’indice », Le Débat, n° 6, 1980/6, pp. 3-44.
10 Laurent Olivier, « Ce qui reste, ce qui s’inscrit. Traces, vestiges, empreintes », Socio-anthropologie, n° 30, 2014, pp. 147-153.
11 Sigmund Freud, Moïse et le monothéisme, Paris, Gallimard, 1948.
12 Georges Didi-Huberman, L’Image survivante : histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris, Minuit, 2002.
13 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire (1940), Paris, Gallimard, 2000.
14 Sur l’articulation entre histoire et mémoire en danse voir Susanne Franco et Marina Nordera (dir.), Ricordanze. Memoria in movimento e coreografie della storia, Torino, UTET Libreria, 2010.
15 Giorgio Agamben, « Note sul gesto », Idem, Mezzi senza fine. Note sulla politica, Torino, Bollati Boringhieri, 1996, p. 48.
16 Mark Franko, « Introduction: The Power of Recall in a Post-Ephemeral Era », in Idem (dir.), The Oxford Handbook of Dance and Reenactment, Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 1-17.
17 Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975.
Marina Nordera est professeure en danse au Département des Arts et au Centre transdisciplinaire d’Épistémologie de la Littérature et des Arts vivants (CTEL) de l’Université Côte d’Azur. Elle est membre fondateur de l’association des Chercheurs en Danse (aCD).
Autres événements et articles qui peuvent vous intéresser

Vente de nos livres d’occasion au prix libre

Offre spéciale pour les fêtes !